Les hôpitaux et les cliniques en France, comme partout dans le monde, ne fonctionnent plus comme avant. Les lits restent vides, pas parce qu’il n’y a pas de patients, mais parce qu’il n’y a plus assez de personnel pour les soigner. Les infirmières travaillent 16 heures d’affilée. Les urgences attendent des jours. Les médecins doivent choisir qui soigner en premier. Ce n’est pas une scène de film. C’est la réalité quotidienne depuis 2023, et ça empire.
Le manque de personnel, pas seulement des médicaments
Quand on parle de pénuries dans le système de santé, on pense souvent aux médicaments. Mais le vrai goulot d’étranglement, c’est les gens. En 2025, plus de 78 000 postes d’infirmières sont vacants en France. Ce chiffre ne comprend même pas les aides-soignants, les techniciens de laboratoire ou les psychologues. Selon les données de l’Agence nationale de santé publique, 42 % des établissements hospitaliers ont du mal à maintenir un ratio de 1 infirmière pour 4 patients. Dans les services de réanimation, ce ratio monte parfois à 1 pour 6. Et quand il dépasse 1 pour 5, les risques de décès augmentent de 7 %, selon une étude publiée dans JAMA en 2022.Le problème, c’est que les infirmières partent. Près de la moitié d’entre elles ont plus de 50 ans. Dans les 10 à 15 prochaines années, un tiers d’entre elles prendront leur retraite. Et il n’y a pas assez de nouvelles recrues pour les remplacer. En 2023, plus de 2 300 candidats qualifiés ont été refusés dans les écoles d’infirmières, simplement parce qu’il n’y avait pas assez de professeurs pour les former. C’est un cercle vicieux : pas assez de professeurs → pas assez d’étudiants → pas assez d’infirmières → plus de stress → plus de départs.
Les urgences, les premières victimes
Les services d’urgence sont devenus des champs de bataille. À Toulouse, comme dans beaucoup de villes de province, les patients attendent parfois plus de 72 heures pour être vus. Ce n’est pas une exception. Selon l’Association française des urgences, le temps d’attente moyen a augmenté de 22 % depuis 2022. Les patients arrivent avec des crises cardiaques, des infections graves, des traumatismes. Et les équipes sont épuisées. Certaines cliniques ont dû fermer des lits parce qu’il n’y avait personne pour les surveiller. D’autres ont mis en place des équipes de soutien psychologique, appelées « code lavande », pour aider le personnel à tenir.Les médecins ne sont pas épargnés. L’Association des médecins généralistes estime que 63 % des praticiens envisagent de quitter leur poste dans les deux ans. Pourquoi ? Parce qu’ils passent plus de temps à remplir des dossiers numériques qu’à regarder un patient dans les yeux. Les systèmes d’information hospitaliers sont lents, mal adaptés, et demandent des heures de formation. 79 % des hôpitaux exigent désormais que les nouveaux recrutés maîtrisent les outils d’intelligence artificielle pour la saisie médicale. Mais qui les forme ? Personne. Les formations durent en moyenne 8,7 semaines, et chaque clinicien doit y consacrer 32 heures. Pendant ce temps, les patients attendent.
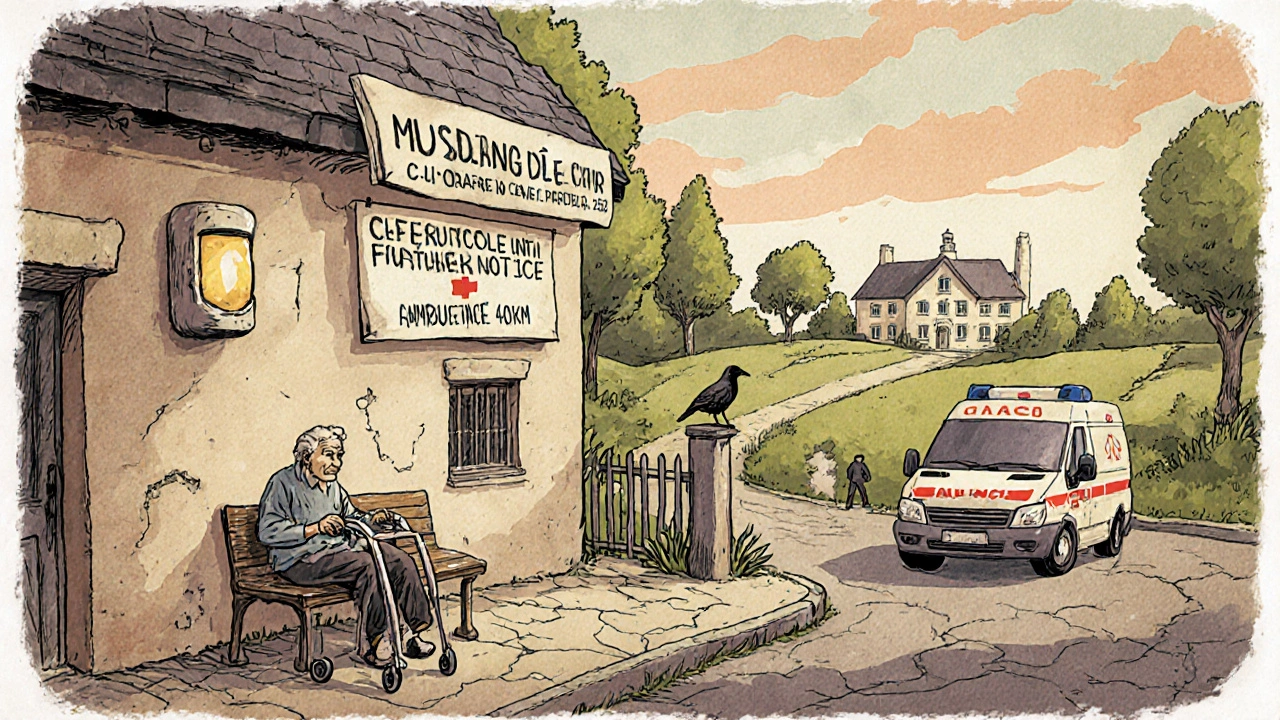
Les zones rurales, les oubliées
Dans les villes, les hôpitaux tentent de se débrouiller avec des contrats de travail à durée déterminée, des infirmières voyageuses, ou des heures supplémentaires obligatoires. Mais dans les zones rurales, c’est la désertification. Les cliniques de campagne ont 37 % de postes vacants de plus que celles des grandes villes. À Saint-Gaudens, dans les Hautes-Pyrénées, la clinique locale a dû réduire ses horaires d’ouverture. Les patients doivent faire 40 kilomètres pour un scanner, 70 pour une consultation spécialisée. Les ambulances mettent deux fois plus de temps à arriver. Les personnes âgées, les plus vulnérables, sont les premières à en souffrir.Les soins à domicile, pourtant promis comme solution, peinent à se développer. Il n’y a pas assez d’aides-soignants pour les visites. Les infirmières libérales sont saturées. Et les plateformes de téléconsultation, bien qu’utiles, ne remplacent pas un examen physique. Une étude de 2024 a montré que les téléconsultations ont réduit les visites aux urgences de 19 %, mais elles ont coûté 2,3 millions d’euros à chaque système de santé pour être mises en place. Et encore, 68 % des hôpitaux n’arrivent pas à connecter leurs systèmes entre eux. Résultat : les dossiers médicaux sont perdus, les ordonnances ne passent pas, les patients sont perdus dans les méandres administratifs.
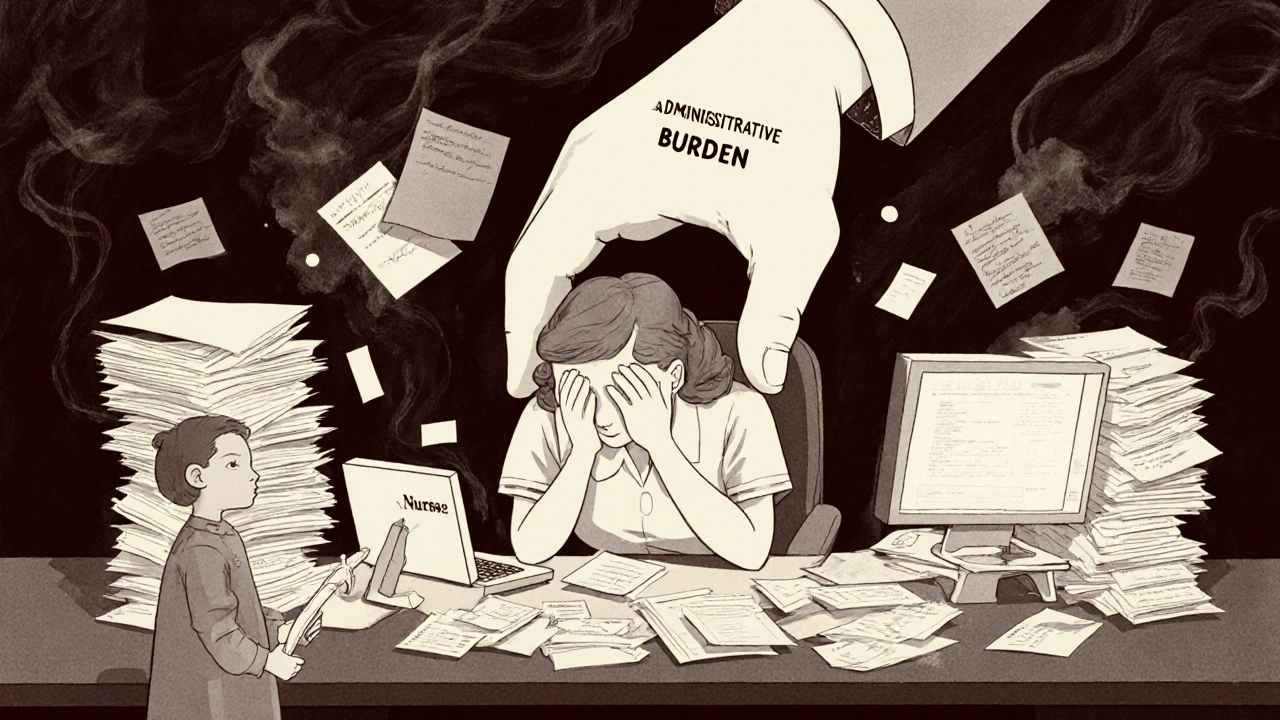
Les solutions proposées… et pourquoi elles échouent
On entend souvent dire : « Il faut plus d’argent. » C’est vrai. Mais l’argent seul ne résout pas le problème. En 2025, le gouvernement a annoncé 500 millions d’euros pour financer les écoles d’infirmières. C’est bien. Mais les experts estiment qu’il en faut 2,8 milliards pour combler le déficit. Ce n’est qu’un tiers du besoin.Les programmes de remboursement d’études, comme ceux mis en place dans certains départements, ont montré des résultats prometteurs. Dans les Hautes-Alpes, une aide de 15 000 euros versée aux infirmières qui s’engagent à rester 5 ans dans un hôpital rural a réduit les départs de 40 %. Mais ces initiatives restent locales. Il n’y a pas de stratégie nationale cohérente.
Les technologies, comme l’IA pour automatiser les tâches administratives, semblent être la réponse miracle. Mais elles ne fonctionnent que si les équipes sont formées, motivées, et suffisamment nombreuses pour les utiliser. Dans un hôpital surchargé, personne n’a le temps d’apprendre un nouveau logiciel. Et quand les outils échouent, c’est encore plus de stress.
Les hôpitaux qui ont réussi, comme le CHU de Montpellier, ont pris une autre voie : ils ont redessiné les équipes. Ils ont regroupé les tâches, délégué certaines fonctions aux aides-soignants, et mis en place des « chefs d’équipe » pour réduire la charge mentale des infirmières. Résultat : une baisse de 31 % du turnover en 18 mois. Mais ça a coûté 4,7 millions d’euros et 217 heures de travail par médecin. Ce n’est pas une solution pour tout le monde.
Que faire maintenant ?
Il n’y a pas de solution simple. Mais il y a des actions urgentes.- Augmenter les salaires et les conditions de travail : une infirmière en réanimation gagne en moyenne 2 800 euros nets par mois. Un agent de sécurité dans un centre commercial gagne 2 600 euros, avec des horaires réguliers. Pourquoi rester dans un métier où on meurt de fatigue ?
- Former davantage de professeurs : chaque professeur d’infirmières peut former 25 étudiants. Il en faut 800 de plus pour répondre à la demande. Pourquoi ne pas transformer les infirmières expérimentées en formateurs à temps partiel, avec une rémunération adaptée ?
- Éliminer les obstacles administratifs : les infirmières qui veulent travailler dans un autre département doivent attendre en moyenne 112 jours pour obtenir leur autorisation. C’est inadmissible.
- Redonner du sens au métier : les soignants ne veulent pas juste être payés. Ils veulent se sentir utiles. Réduire les tâches administratives, rétablir le contact humain, écouter leurs idées - c’est ce qui les retiendra.
Le système de santé ne va pas s’effondrer demain. Mais il va continuer à se dégrader, jour après jour, jusqu’à ce que personne ne puisse plus tenir. Les patients le savent. Les soignants le savent. Les politiques le savent aussi. Le problème, c’est que personne n’a encore pris la décision difficile : investir vraiment, maintenant, dans les gens qui font tourner le système. Pas dans les machines. Pas dans les rapports. Dans les humains.
Pourquoi les infirmières partent-elles en masse ?
Les infirmières partent principalement à cause de la surcharge de travail, des horaires impossibles et du manque de reconnaissance. En 2025, 63 % d’entre elles envisagent de changer de métier, selon le rapport Medscape. La principale raison citée est le ratio patient/infirmière trop élevé - parfois jusqu’à 1 pour 6 en réanimation. Elles ne se sentent plus en sécurité, ni pour elles, ni pour leurs patients.
Les hôpitaux privés sont-ils moins touchés que les publics ?
Non. Les hôpitaux privés sont aussi en crise, mais leur modèle leur permet de réagir différemment. Ils paient mieux les infirmières voyageuses, utilisent plus d’IA pour réduire la charge administrative, et proposent des contrats plus flexibles. Mais ils ne peuvent pas absorber tout le système. La majorité des patients, surtout les plus vulnérables, dépendent encore du service public. Et là, les moyens manquent cruellement.
La téléconsultation peut-elle résoudre la pénurie ?
La téléconsultation aide à soulager les urgences, mais elle ne remplace pas les soins physiques. Elle est utile pour les suivis chroniques ou les consultations légères. Mais pour un patient âgé avec une infection urinaire, une douleur thoracique ou une plaie infectée, il faut un examen physique. De plus, 68 % des établissements n’arrivent pas à connecter leurs systèmes de dossiers médicaux, ce qui rend la téléconsultation inefficace ou dangereuse.
Pourquoi les écoles d’infirmières ne forment-elles pas plus d’étudiants ?
Parce qu’il n’y a pas assez de professeurs. Les infirmières expérimentées qui veulent enseigner sont souvent trop fatiguées pour quitter leur poste de soins. Et les salaires des enseignants sont inférieurs à ceux des praticiens en activité. En 2023, plus de 2 300 candidats qualifiés ont été refusés dans les écoles d’infirmières - pas parce qu’ils étaient mauvais, mais parce qu’il n’y avait pas de place. C’est un blocage structurel.
Quels sont les impacts à long terme si rien ne change ?
Si rien ne change, les hôpitaux devront fermer des services. Les soins de base, comme les consultations de pédiatrie ou les suivis de diabète, deviendront inaccessibles dans les zones rurales. Les urgences seront saturées, avec des délais de plusieurs jours. Les décès évitables augmenteront. Et le système deviendra si inefficace qu’il perdra toute crédibilité. Ce n’est pas une hypothèse lointaine : c’est ce que vivent déjà certains départements en 2025.
titi paris
Le système de santé français est en état de décomposition structurelle : sous-financement chronique, bureaucratisation pathologique, et désengagement politique systémique. Les indicateurs sont clairs - taux de rotation des infirmières, ratio patients-soignants, délais d’attente - et ils dépassent tous les seuils de sécurité internationaux. Pourtant, les réponses restent cosmétiques : subventions ponctuelles, campagnes de recrutement mal ciblées, et une obsession pour les outils numériques qui aggravent la charge cognitive. La cause profonde ? Une vision néolibérale du soin, où l’humain est réduit à une variable de coût.
Corinne Stubson
Vous savez ce qui se passe vraiment ? Les lobbys pharmaceutiques ont fait pression pour que les hôpitaux passent à la téléconsultation, parce que ça leur permet de vendre plus de médicaments sans contrôle médical. Les infirmières sont épuisées, oui, mais c’est aussi parce qu’on leur impose des protocoles qui servent les intérêts des assureurs, pas des patients. Et les politiques ? Ils sont tous dans la poche de Big Pharma. Vous avez vu combien de fois on a parlé de ça dans les médias ? Zéro. C’est un silence organisé.
Gilles Donada
On a tout essayé. Ça marche pas. Fini.
Yves Perrault
Alors là je rigole. On parle de 500 millions pour les écoles mais personne n’a osé dire que les infirmières gagnent moins qu’un caissier de supermarché. Et les médecins ? Ils passent 6h par jour à remplir des formulaires pour que quelqu’un dans un bureau de Paris puisse valider qu’un patient a bien eu une prise de sang. On a transformé la médecine en jeu vidéo où le score c’est le nombre de cases cochées. Et on s’étonne que les gens démissionnent ?
Stéphane PICHARD
Je veux dire… on a tous vu ce que ça fait de travailler dans ce système. Mais ce qui est tragique, c’est qu’il y a encore des gens qui veulent entrer dans le métier. Je connais une jeune infirmière qui a fait trois ans de stage, elle a vu des patients mourir parce qu’il n’y avait personne pour les surveiller. Elle a pleuré pendant une semaine. Et pourtant, elle est restée. Pourquoi ? Parce qu’elle croit encore en l’humain. Ce qu’on doit faire, ce n’est pas juste payer plus - c’est redonner du sens. Redonner du temps. Redonner la possibilité de regarder un patient dans les yeux sans avoir une alarme qui sonne toutes les 12 minutes. Ce n’est pas une réforme qu’il faut, c’est une révolution douce. Et elle commence par écouter ceux qui sont sur le terrain.
elisabeth sageder
Je suis infirmière depuis 17 ans et je peux vous dire que la fatigue ne vient pas seulement des heures. Elle vient du fait qu’on se sent inutile. On fait tout ce qu’on peut mais personne ne voit ce qu’on fait. Quand un patient me dit merci parce que je lui ai tenu la main pendant qu’il se faisait opérer, là je me dis que ça vaut le coup. Mais ça devrait être la norme, pas l’exception. On a besoin de reconnaissance, pas de discours. Juste de savoir qu’on compte.
Teresa Jane Wouters
Et si c’était juste une illusion ? Les statistiques sont truquées. Les hôpitaux comptent les lits vides comme des lits disponibles même s’il n’y a personne pour les occuper. Les chiffres des décès évitables sont gonflés par les médecins qui veulent faire peur pour obtenir plus de budget. La vraie crise ? C’est la peur. La peur des patients, la peur des soignants, la peur des politiques. Et tant qu’on parlera de pénuries, on ne parlera jamais de ce qui se passe dans les têtes.
Gert-jan Dikkescheij
À Genève, on a mis en place des équipes mobiles de soins à domicile avec des infirmières qui ont un véhicule et un téléphone dédié. Pas de paperasse en ligne - juste un tablette avec une interface simple. Le résultat ? 40 % de réduction des passages aux urgences pour les personnes âgées. Ce n’est pas la technologie qui sauve, c’est la simplicité. On a simplifié les processus, on a délégué les tâches, et on a redonné du temps aux soignants. C’est faisable. Il faut juste vouloir le faire.
Thomas Sarrasin
Je trouve que ce post est très bien documenté. Merci pour le travail. J’ai lu les études citées, et les chiffres sont cohérents avec ce que j’ai vu dans les hôpitaux de la région. C’est triste, mais pas surprenant.
Arnaud HUMBERT
Je travaille dans un hôpital en Normandie. On a un service de réanimation qui tourne avec 3 infirmières pour 18 patients. On a un médecin qui fait deux services en même temps. On a des aides-soignants qui font des tâches d’infirmières parce qu’il n’y en a plus. Et pourtant, on s’en sort. Pas bien. Mais on s’en sort. Parce qu’on s’entraide. Parce qu’on rigole pour pas pleurer. Ce n’est pas le système qui est cassé. C’est la manière dont on le voit. On a besoin de solidarité, pas de slogans.
Jean-françois Ruellou
STOP aux discours. Il faut agir MAINTENANT. On ne peut plus attendre une nouvelle loi ou un nouveau rapport. Il faut augmenter les salaires de 40 % dès janvier, recruter 10 000 professeurs d’infirmières avec des contrats à durée indéterminée, et supprimer les systèmes informatiques qui font perdre 3 heures par jour à chaque soignant. On a les moyens. On a les compétences. Ce qu’on n’a pas, c’est la volonté politique. Et ça, c’est un choix. Un choix criminel.
Marc Garnaut
La véritable pénurie, c’est la pénurie de reconnaissance épistémologique. Les soignants ne sont pas des ressources humaines - ils sont des agents d’intersubjectivité, des médiateurs du corps dans sa vulnérabilité. Leur épuisement n’est pas un problème de gestion, c’est un échec civilisationnel. On a déshumanisé le soin en le transformant en flux opérationnel, en KPI, en tableau de bord. On a oublié que la médecine n’est pas une logistique - c’est une éthique incarnée. Et quand on éradique l’éthique, on éradique la vie. La crise du système de santé n’est pas une crise sanitaire. C’est une crise de l’humanité.